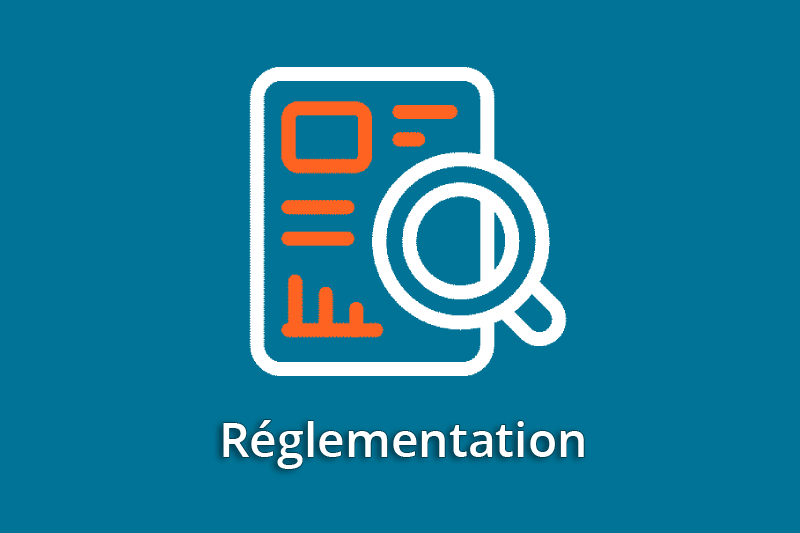Intervention sur véhicule hydrogène en feu
La mobilité hydrogène embarque généralement une pile à combustible et un réservoir d’hydrogène sous haute pression. L’intervention sur ce type de véhicule en feu présente des risques particuliers, et nécessite une approche spécifique.

À l’image de la catastrophe du Zeppelin Hindenburg (1937) qui a marqué les esprits, les pompiers ont en mémoire, lorsqu’ils abordent l’énergie gaz en matière de mobilité, les premiers déboires des véhicules fonctionnant au GPL dans les années 2000.
Notamment à Vénissieux le 31 janvier 1999, l’explosion du réservoir GPL d’un véhicule volé. La projection du réservoir heurte les pompiers en intervention. L’un est gravement blessé (jambe sectionnée), cinq autres sont conduits à l’hôpital. Depuis, la réglementation impose une soupape de sécurité sur les réservoirs des véhicules fonctionnant au GPL.
Un fusible sur le réservoir d’hydrogène
Pour minimiser le risque d’explosion, le même principe a été appliqué aux véhicules embarquant de l’hydrogène : les réservoirs sont munis d’un élément fusible qui va libérer entièrement le gaz sous pression (de 200 à 750 bars selon les véhicules) à partir d’une certaine température (de l’ordre de 110 °C).
Le bris de cet opercule se traduit par un jet d’hydrogène en partie haute ou basse sur la partie arrière du véhicule, endroit où les constructeurs positionnent généralement les réservoirs.
Rappelons que l’hydrogène est un gaz hautement réactif, et que sa libération soudaine risque de s’accompagner d’une inflammation instantanée. D’autre part, sa combustion se fait sans flamme visible ni fumée, ce qui complique la perception du jet enflammé sous pression.
Exercice d’extinction d’un véhicule à hydrogène par le Sdis 86.
Technique d’approche, moyens engagés
L’approche des forces de secours sur un feu de véhicule « hydrogène » est similaire à celle des véhicules mus par d’autres gaz (GPL, GNV, GNC…). La méthode développée par les Services départementaux d’incendie et de secours, le Sdis 86 étant particulièrement moteur sur le sujet, se déroule en trois temps :
- sécuriser l’action des secours ;
- refroidir les sources d’énergie ;
- procéder à l’extinction du véhicule.
Prise d’information
Dans le premier temps, la prise d’information relative à l’énergie embarquée par le véhicule est primordiale. Les FAD (fiches d’aides à la désincarcération) éditées par les constructeurs dans le cadre de la norme 17840, ainsi que la signalétique sont de première importance. Car en sus d’un réservoir d’hydrogène, une batterie haute tension de type lithium-ion est bien souvent présente dans le véhicule, ce qui constitue un risque supplémentaire.
Refroidissement et extinction
La technique d’approche est routinisée : elle consiste à poster un engin-pompe à 50 mètres de l’avant du véhicule enflammé, afin de ménager un abri aux intervenants tout en les mettant hors de portée des libérations de flux de gaz enflammé.

Christopher Henoch, responsable du Pôle opérationnel incendie et environnement à CNPP, nous détaille la suite:
« Deux binômes et un chef d’équipe sont engagés, en tenue de feu complète et sous appareil respiratoire isolant. Chaque binôme est équipé d’une lance à eau. Tous deux vont commencer à attaquer à distance, en jet droit: l’un sur la zone du réservoir pour le refroidir, l’autre sur les flammes pour favoriser l’extinction. Au fur et à mesure de l’approche, les binômes vont ouvrir la conicité du jet. Au final, sans jamais passer derrière le véhicule, un binôme va se poster sur le côté pour refroidir le réservoir, l’autre va se concentrer sur l’extinction des flammes. »
Article extrait du n° 574 de Face au Risque : « L’hydrogène en lumière » (juillet-août 2021).

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef
Les plus lus…
Pour le monde de la culture, le cambriolage du Louvre du 19 octobre constitue « une catastrophe patrimoniale ». De fait,…
Fin 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de partager les…
L’instruction du 23 décembre 2025 émanant du ministère de la Transition écologique a fixé les priorités de l’inspection des…
Le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de la construction des…
En cohérence avec le déploiement de Dracar Ultimate, le futur système d’information du Cnaps, le décret n° 2025-1344 du…
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances…