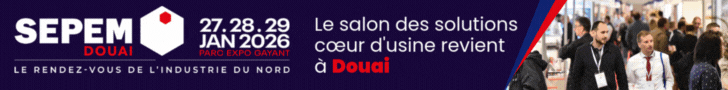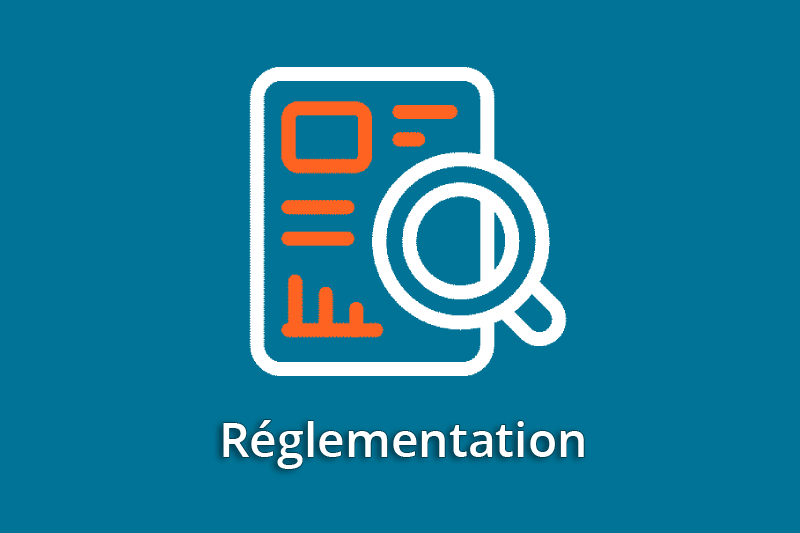Administrations et collectivités territoriales / Assurance / BTP / Incendie/explosion / Sécurité civile et forces de l'ordre
Détecteurs de fumée dans les logements : dix ans après l’obligation, le besoin d’un nouvel élan
Entrée en vigueur en 2015, la loi « Morange » a imposé la présence de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (Daaf) en habitation individuelle ou collective. Sous l’impulsion de la FFMI, un premier bilan positif de cette obligation a été présenté courant juin 2025.

En France, le 8 mars 2015 a marqué l’irruption de la sécurité incendie dans la sphère domestique, avec l’entrée en vigueur du texte rendant obligatoire la présence d’au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf) dans chaque logement. L’occasion de rappeler que 80 % des décès causés par l’incendie le sont du fait des fumées, et que les 30 % des départs de feux observés la nuit en habitation sont à l’origine de 70 % des victimes recensées.
En 2025, un peu plus de dix ans après la date fondatrice, le temps est venu d’évaluer l’efficacité de la loi « Daaf ». Une réflexion d’autant plus nécessaire qu’une grande partie des Daaf installés dans les habitations sont arrivés au terme de leur durée de vie, ou ne sont pas fonctionnels.
30 % des départs de feux observés la nuit en habitation sont à l’origine de 70 % des victimes recensées.
Incendies en habitation : un drame silencieux
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
Fin 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de partager les…
L’instruction du 23 décembre 2025 émanant du ministère de la Transition écologique a fixé les priorités de l’inspection des…
Le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de la construction des…
En cohérence avec le déploiement de Dracar Ultimate, le futur système d’information du Cnaps, le décret n° 2025-1344 du…
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et…