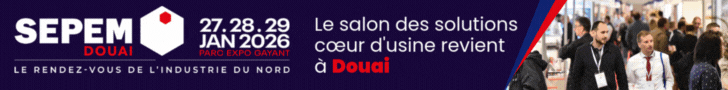Code du travail : que faire en cas d’arrêt de fonctionnement de la centrale SSI ?
Que prévoit la réglementation contenue dans le code du travail en cas d’arrêt de la centrale SSI ? Doit-on évacuer le bâtiment si les blocs autonomes de sécurité s’éteignent au bout d’une heure ?

Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux principes réglementaires fixés par :
- l’article L. 4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés ;
- l’article R. 4227-28 du même code qui impose à l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattus dans l’intérêt du sauvetage du personnel».
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
Le 28 janvier 1986, la navette spatiale américaine Challenger explose après seulement 73 secondes de vol, provoquant la mort des…
Handicapé par un manque de visibilité sur l’avenir économique et politique du pays, le marché de la sécurité entre…
Le baromètre des risques Allianz 2026 a été publié le 14 janvier par Allianz Commercial. Les risques liés à…
En matière de sécurité incendie, le plan d’intervention et le plan d’évacuation font souvent l’objet de confusion pour les non-spécialistes.…
À la fin de l’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
Dossier de demande d'autorisation environnementale, vie de l'installation : quand et comment un site Seveso doit-il consulter ou informer…