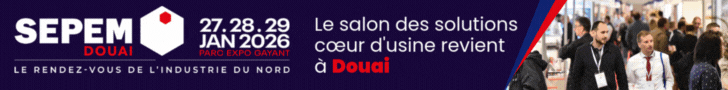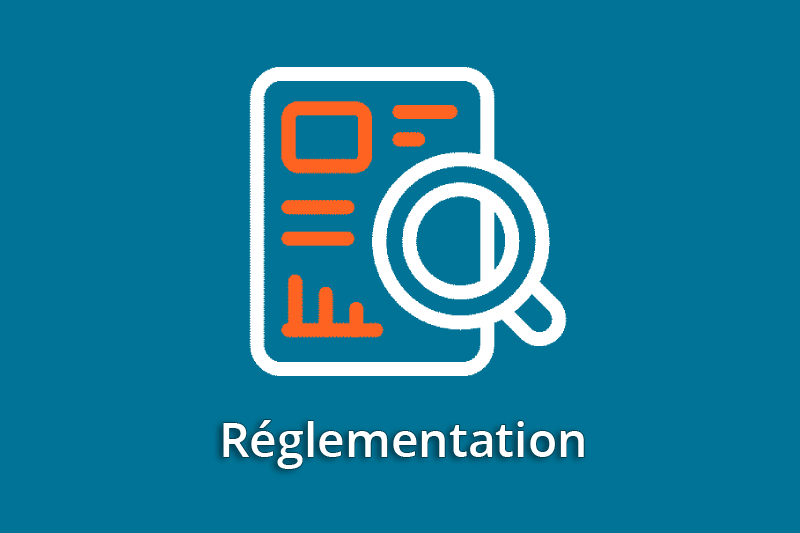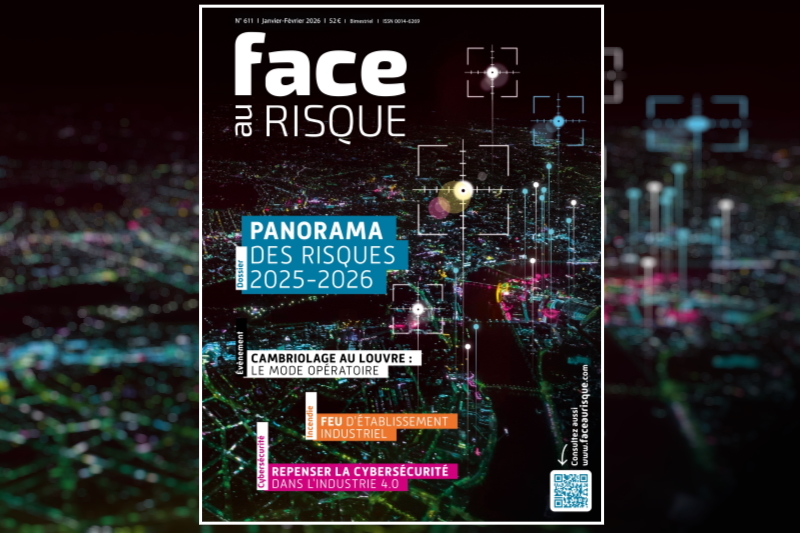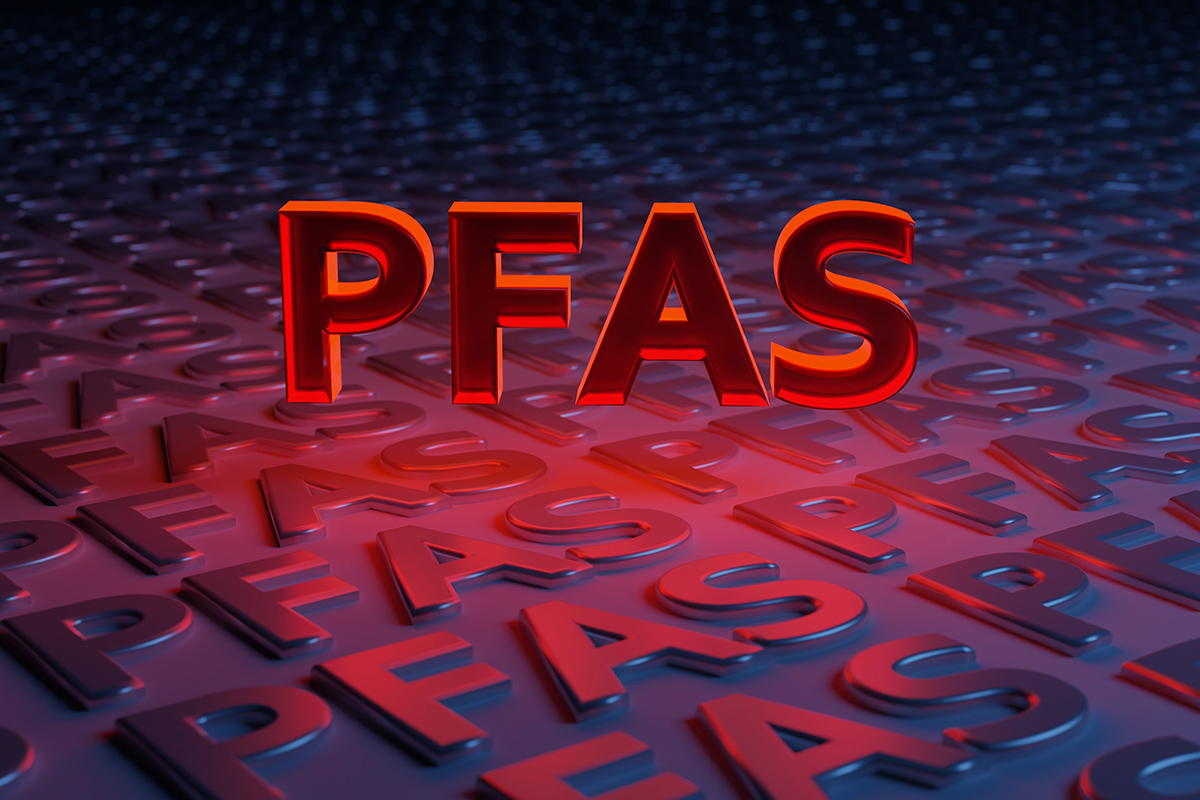ICPE : les éléments clés d’une visite d’inspection réussie
Les rapports de visites d’inspection en ICPE matérialisent les faits et conclusions à retenir des opérations de contrôle menées par l’autorité administrative sur les sites industriels. Cet article fait le point sur leur contenu et les suites qui peuvent y être apportées.

À l’origine du rapport, une visite d’inspection
Afin de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (CdE), le préfet de département ou, à Paris, le préfet de Police, contrôle le respect par l’exploitant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans la pratique et sous l’autorité du préfet, l’inspection des installations classées (IIC) exerce les missions de police en matière d’ICPE, en particulier les visites de contrôle des installations. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pour autant pas exhaustif, mais centré sur des enjeux principaux, redéfinis chaque année par le ministère de l’Environnement dans le programme annuel de l’IIC (pour 2025, cf. instruction du 3 décembre 2024).
La plupart des visites d’inspection sont annoncées à l’exploitant, généralement 15 jours à l’avance, dans le cadre du suivi administratif de l’installation, mais certaines sont inopinées (actions « coup de poing » pour faire cesser une situation illégale, visite après une plainte ou un accident, ou encore test de certains dispositifs tels que le plan d’opération interne).
À noter : le cas particulier des ICPE soumises à déclaration
Les ressources limitées de l’IIC ne lui permettent pas d’intégrer les ICPE à déclaration dans son plan de contrôle, en dehors d’opérations ciblées. C’est pourquoi le contrôle périodique de ces installations a été délégué par l’État à des organismes privés agréés (article R. 512-61 du CdE). Le coût de ces opérations de contrôle est supporté par l’exploitant.
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
Ce texte a pour objet les modalités d’application des articles CTS 30 (registre de sécurité) et CTS 34 (vérification de…
Le décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux…
Le décret n° 2025-1349 du 26 décembre 2025 modifie les tableaux de maladies professionnelles n° 16 bis et n°…
Le 14 octobre 2025, un incendie s’est déclaré au sein d’une usine de production de pièces de plastique thermoformées située…
Ce numéro 611 du magazine Face au Risque consacre un dossier spécial à un panorama des risques 2025 -…
Pour le monde de la culture, le cambriolage du Louvre du 19 octobre constitue « une catastrophe patrimoniale ». De fait,…