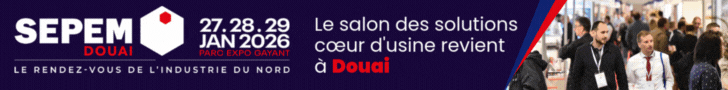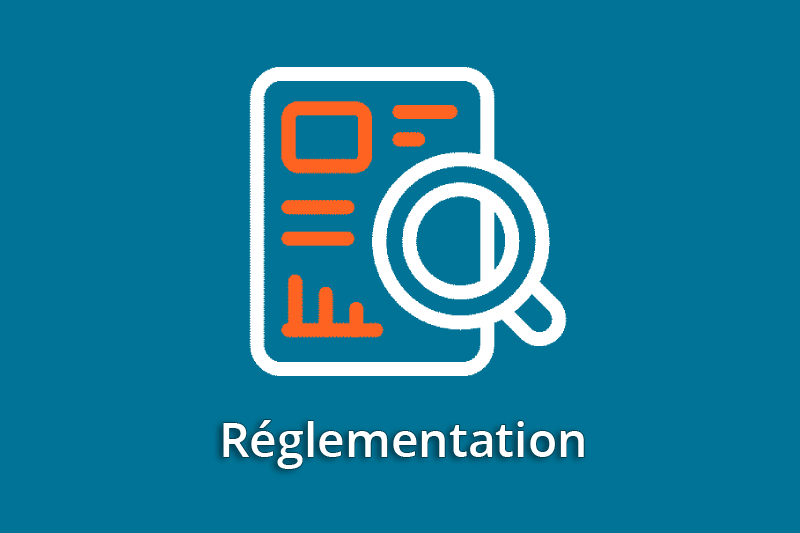Feu d’immeuble « bas carbone » en construction
Le 15 juillet 2025, les sapeurs-pompiers sont alertés pour un « feu dans un immeuble en construction, avec explosions de bouteilles de gaz ». Ils vont être confrontés à un feu retors, dans un imposant complexe de huit étages dont les cinq derniers niveaux sont en bois.

Peu après 17 h, le 15 juillet 2025, les sapeurs-pompiers sont alertés pour un incendie sur le chantier de l’immeuble « Messager ». Un feu a éclaté au 4e étage d’un bâtiment en comptant sept, en cours de construction. Une à deux explosions ont été ressenties. Un premier groupe de véhicules est engagé. À l’arrivée des secours, de la fumée s’échappe du bâtiment.
Guidés par le personnel, les sapeurs-pompiers s’engagent dans l’un des deux escaliers encloisonnés dans une trémie de béton, mais non étanche aux fumées. Sa stabilité permet l’établissement d’une première lance, sur le foyer principal, tandis qu’une seconde lance, à grande puissance, est mise en œuvre au 5e pour enrayer les propagations. Les étages supérieurs s’enfument progressivement, compliquant les reconnaissances au-dessus du 4e. Les huisseries de fenêtres et les vitrages sont en place sur une très grande partie des façades.
Risque d’effondrement de l’immeuble bas carbone en construction
Des explosions de bouteilles de gaz sont ressenties du 4e au 6e et une dizaine de bouteilles sont bientôt regroupées à l’abri du feu. Un groupe habitation* est demandé en renfort peu avant 18 h. Les équipes engagées au 4e remarquent qu’un plafond de fumée descend rapidement à l’étage, avant que brutalement les 4e et 5e niveaux s’embrasent dans leur quasi-totalité ! L’attaque par l’intérieur est devenue impossible. La structure bois commence à s’effondrer sur elle-même, au cœur de l’édifice. L’ordre de repli général est lancé vers 18 h 30. Lances et tuyaux sont abandonnés sur place. Une seconde vague de renforts est demandée. Un périmètre de sécurité est établi, de nombreuses chutes de matériaux se produisant en périphérie du sinistre.
Le dispositif se réarticule sur une attaque extérieure, massive, à partir de moyens aériens, échelle et bras élévateurs de 32 et 42 mètres. Avant 18 h 30, le message suivant est passé : « Les secours sont confrontés à un feu d’immeuble en construction totalement embrasé du 4e au 7e étage. Tous les ouvriers ont été évacués. Le bâtiment en structure bois pourrait présenter des risques d’affaissement. Explosions ressenties, nombreux débris projetés au rez-de-chaussée. Risque de propagation aux niveaux inférieurs présent. »
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
L’instruction du 23 décembre 2025 émanant du ministère de la Transition écologique a fixé les priorités de l’inspection des…
Le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de la construction des…
En cohérence avec le déploiement de Dracar Ultimate, le futur système d’information du Cnaps, le décret n° 2025-1344 du…
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…