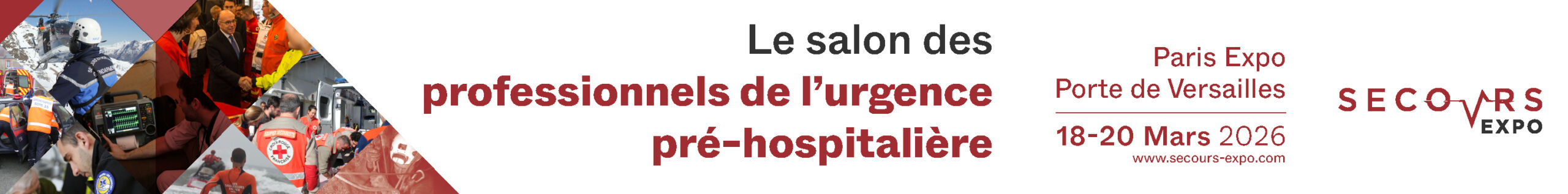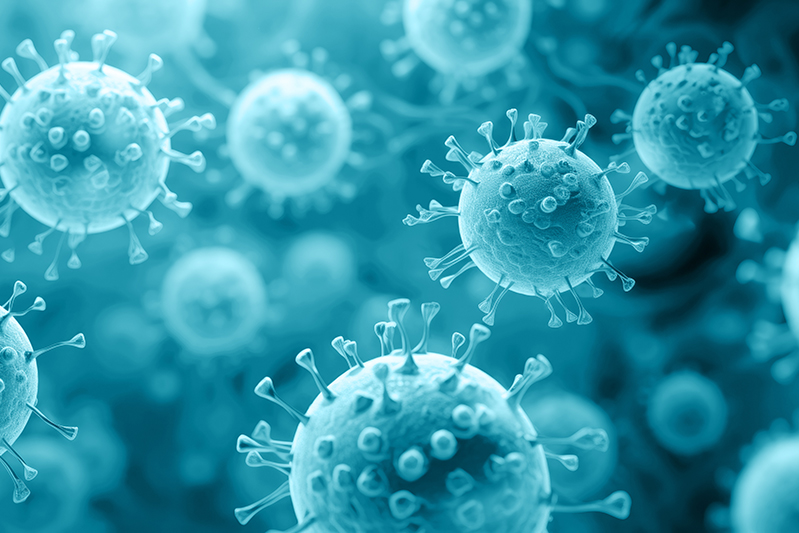La responsabilité des secours publics en intervention : des recours de plus en plus nombreux
Les recours visant la mise en cause de la responsabilité des services de secours par les victimes constituent un mouvement d’ampleur. Décryptage de ce phénomène du point de vue réglementaire et jurisprudentiel.

Responsabilité des secours publics en intervention : un contentieux croissant
Alors même qu’ils font partie des professions les plus appréciées au monde, les pompiers, les médecins et autres acteurs des secours publics sont confrontés aux attentes de plus en plus élevées de la population dans le cadre de leurs interventions. Ces dernières sont scrutées à la loupe avec un niveau d’exigence auparavant jamais atteint.
On leur demande toujours plus de réactivité, toujours plus d’efficacité, avec un degré d’acceptabilité de l’échec proche de zéro. Cette situation revient à mettre à la charge des services de secours une forme d’« obligation de résultat », sous peine de voir leur responsabilité recherchée.
« Cette situation revient à mettre à la charge des services de secours une forme d’« obligation de résultat », sous peine de voir leur responsabilité recherchée. »
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
En ce moment
Le GPMSE (Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Électronique) organise son congrès annuel les jeudi 11 et vendredi 12…
Au 2e trimestre 2025, le nombre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) validés et/ou homologués a augmenté de…
Fin novembre 2025, Euralarm a publié un nouveau document d'orientation sur les mesures de précaution pour la protection des…
La nouvelle norme ISO 3941:2026 introduit une nouvelle classe de feu : la classe L dédiée aux feux de…
On parle également d’embrasement généralisé éclair (EGE) pour désigner le flash-over et d’explosion de fumées pour désigner le backdraft (qui…
Le 28 janvier 1986, la navette spatiale américaine Challenger explose après seulement 73 secondes de vol, provoquant la mort des…