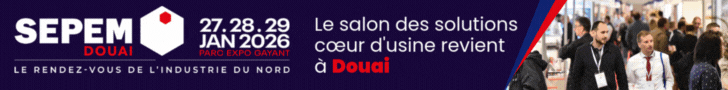Risques d’explosion en zone Atex : comprendre et prévenir efficacement
Avant toute intervention en zone Atex, il est essentiel d’évaluer précisément le risque d’explosion. Une atmosphère explosive se forme lorsque des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières combustibles se mélangent à l’air dans certaines conditions. Identifier, classer et caractériser ces zones permet de définir les mesures de prévention adaptées et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. Avant d’effectuer des travaux, cette analyse est donc une étape obligatoire pour éviter tout déclenchement accidentel d’une explosion.

Une atmosphère explosive est un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel, après que l’inflammation s’est produite, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé. Une atmosphère explosive dangereuse est une atmosphère explosive qui, si elle explose, entraîne un dommage.
Une atmosphère explosible est une atmosphère susceptible de devenir explosive par suite de conditions locales et opérationnelles.
La réglementation pour les zones Atex
Les textes suivants s’appliquent aux atmosphères explosibles :
- la directive européenne 94/9/CE relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (dite directive Atex, remplacée à compter du 20 avril 2016 par la directive 2014/34/UE du 26 février 2014) transposée en droit français par le décret du 19 novembre 1996 modifié (remplacé à compter du 20 avril 2016 par les dispositions du code de l’environnement relatives aux produits et équipements à risques (articles R. 557-1-1 et suivants créés par le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015) ;
- la directive européenne 1999/92/CE relative à l’amélioration de la protection des travailleurs exposés au risque d’atmosphères explosives (dite directive Atex), transposée en droit français et codifiée aux articles R. 4227-42 à 54 et R. 4216-31 du Code du travail qui définit la prévention des explosions pour les employeurs et pour les maîtres d’ouvrage ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 complétant l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive ;
- l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Risque explosion, les caractéristiques d’explosivité et d’inflammabilité
Pour identifier le phénomène dangereux de l’explosion, différentes caractéristiques sont à prendre en compte : la combustion, l’inflammation et le comportement lors de l’explosion.
Risque Atex, les caractéristiques de combustion de l’atmosphère explosible
Si l’on considère la définition de l’atmosphère explosible, les caractéristiques du mélange de la substance inflammable avec l’air doivent être déterminées. Il faut notamment prendre en compte :
- le point d’éclair, la température minimale à laquelle, dans des conditions d’essais spécifiées, un liquide donne suffisamment de gaz ou de vapeur combustible capable de s’enflammer momentanément en présence d’une source d’inflammation active ;
- les limites du domaine d’explosivité. Il faut considérer la LIE (limite inférieure du domaine d’explosivité) et la LSE (limite supérieure du domaine d’explosivité) ;
- la concentration limite en oxygène (CLO), ou le cap en oxygène. Il s’agit de la concentration maximale en oxygène d’un mélange de substances inflammables, d’air et d’un gaz inerte dans lequel une explosion ne se produit pas.
Les caractéristiques d’inflammation de l’atmosphère explosible
Pour identifier un phénomène dangereux, les caractéristiques d’inflammation de l’atmosphère explosive doivent également être déterminées. Il faut tenir compte par exemple de :
- l’énergie minimale d’inflammation. L’énergie minimale d’inflammation (EMI), exprimée en joules, permet de classer les substances inflammables (gaz, vapeur ou brouillard). C’est la plus faible énergie (énergie électrique stockée dans une capacité, dans des conditions d’essais) qui, lors de la décharge, est juste suffisante pour obtenir l’inflammation de l’atmosphère la plus facilement inflammable ;
- la température minimale d’inflammation d’une atmosphère explosive ;
- la température minimale d’inflammation d’une couche de poussières.
Le comportement de l’atmosphère explosible après l’inflammation
Le comportement de l’atmosphère explosive après inflammation doit être caractérisé par des données telles que :
- la pression maximale d’explosion pmax, pression maximale obtenue dans un récipient fermé lors de l’explosion d’une atmosphère explosible ;
- la vitesse de montée en pression de l’explosion (dp/dt) max, dans des conditions d’essais spécifiées, valeur maximale de la montée en pression par unité de temps obtenue dans un récipient fermé lors de l’explosion ;
- l’interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS), exprimé en mm. C’est l’interstice maximal du joint entre les deux parties de la chambre interne d’un appareil d’essai qui, lorsque le mélange gazeux interne est enflammé et dans des conditions spécifiées, empêche l’inflammation d’un mélange gazeux externe à travers un joint de 25 mm de longueur, quelle que soit la concentration dans l’air du gaz ou de la vapeur essayés. L’IEMS est une propriété du mélange de gaz donné.
Les travaux en zone Atex
Certains travaux peuvent être des sources d’inflammation et, lorsqu’ils sont réalisés dans des zones à atmosphère explosive (Atex), être à l’origine d’explosions graves et/ou d’incendies. Ils nécessitent la formalisation d’une autorisation de travail, dit « permis Atex ».
La réglementation ne liste pas les travaux dangereux nécessitant la formalisation d’une autorisation de travail en zone Atex à l’exception des mesurages électriques réalisés dans le cadre des vérifications périodiques ou de la maintenance des installations électriques.
Les travaux dangereux en atmosphère explosive
Ces travaux dits « dangereux » sont donc définis pour chaque entreprise, en fonction de son activité et sous la responsabilité de l’employeur. Ce sont notamment les travaux par point chaud ou les travaux mettant en œuvre l’une des treize sources d’inflammation définies par la norme NF EN 1127-1 relative aux atmosphères explosives :
- les surfaces chaudes ;
- les flammes et les gaz chauds ;
- les étincelles d’origine mécanique ;
- les matériels électriques ;
- les courants vagabonds, les protections cathodiques ;
- l’électricité statique ;
- la foudre ;
- les ondes électromagnétiques radiofréquences ;
- les ondes électromagnétiques autres ;
- les rayonnements ionisants ;
- les ultrasons ;
- les compressions adiabatiques et les ondes de choc ;
- les réactions exothermiques (dont l’auto-inflammation des poussières).
Entrent par exemple dans cette catégorie les contrôles non destructifs avec des appareils à ultrasons, la prise de mesures utilisant un télémètre laser ou un thermomètre électronique, le nettoyage des installations nécessitant l’utilisation d’un aspirateur industriel par exemple.
Le permis de travail en zone Atex et les mesures de prévention
Établi préalablement à toute opération pouvant présenter un risque et réalisée en zone Atex, le permis de travail prévoit les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être réalisés en toute sécurité. Il peut constituer si besoin un mode de preuve et l’assurance :
- qu’une analyse de risques a été menée en préalable à la réalisation des travaux ;
- que des moyens de maitrise ont été définis.
Les mesures de prévention agissant sur la présence d’Atex peuvent être de plusieurs natures :
- supprimer l’atmosphère explosive, en agissant sur l’un des trois éléments de base constituant le mélange explosif (le combustible, le comburant ou la concentration du mélange) ;
- surveiller l’atmosphère explosive, en monitorant en permanence le niveau de concentration du mélange explosif au moyen d’un équipement de mesure ;
- cadrer les actions à entreprendre en cas de défaillance du ou des moyens de maitrise (sécurisation du personnel présent dans la zone, etc.) ;
- limiter les sources d’inflammation a un niveau non dangereux (arrosage des surfaces chaudes, surveillance de la température des équipements, etc.) ;
- limiter l’électricité statique et les étincelles (vêtements et équipements de protection individuelle de l’opérateur adaptés, outillage certifié Atex) ;
- former les intervenants.
Conclusion : anticiper et maîtriser le risque Atex
La prévention du risque Atex exige une vigilance constante et une parfaite connaissance des environnements explosifs. Identifier les zones, contrôler les sources d’inflammation et appliquer les procédures de sécurité adaptées sont indispensables pour limiter les accidents. En adoptant une démarche proactive, les entreprises protègent leurs équipes, leurs équipements et assurent la pérennité de leurs activités face aux risques d’explosion.
La maîtrise du risque Atex repose sur une approche rigoureuse et continue : identifier les zones à risque, évaluer les sources potentielles d’inflammation et mettre en œuvre des dispositifs de prévention adaptés. Chaque acteur intervenant en zone explosive doit être sensibilisé, formé et équipé selon les exigences réglementaires. Prévenir le risque Atex, c’est avant tout protéger les personnes, les installations et la continuité de l’activité. Une évaluation régulière et une signalétique claire sont les clés d’une sécurité durable face aux atmosphères explosives.
En savoir plus
Consultez la réglementation risque Atex.
À lire également
Notre article “Atmosphères explosives, comment prévenir l’explosion ?“.
Les plus lus…
Le baromètre des risques Allianz 2026 a été publié le 14 janvier par Allianz Commercial. Les risques liés à…
En matière de sécurité incendie, le plan d’intervention et le plan d’évacuation font souvent l’objet de confusion pour les non-spécialistes.…
À la fin de l’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
Dossier de demande d'autorisation environnementale, vie de l'installation : quand et comment un site Seveso doit-il consulter ou informer…
Fin 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de partager les…
Les pannes informatiques mondiales de 2025 (CrowdStrike, Microsoft Azure) et la multiplication des cyberattaques ont mis en lumière un problème…