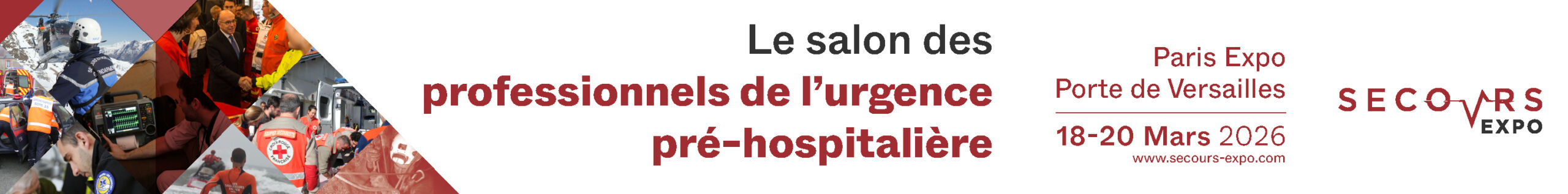Hôpitaux : une sécurité à problèmes spécifiques
Alors qu’une loi a été votée en juillet 2025 pour renforcer la sécurité des professionnels, les établissements de santé rencontrent de nombreuses difficultés – financières, culturelles, technologiques – pour modifier leur organisation face à une violence qui s’est installée à des degrés divers.

Jadis considéré comme un îlot de tranquillité et d’accueil, l’hôpital est devenu un lieu comme les autres sur le plan des incivilités, de la délinquance et de la malveillance : en 2022, un professionnel de santé hospitalier sur trois a déclaré subir des agressions physiques, selon le baromètre MNH-Odoxa.
Un environnement très variable selon les hôpitaux
« La situation est globalement difficile et surtout très variable d’un établissement à un autre », nous déclare Romain Fortier, responsable sécurité et sûreté du centre hospitalier de l’Estran et auteur d’un livre qui vient de paraitre, intitulé « La sûreté à l’hôpital ».
« Il n’existe pas de culture sécurité homogène dans les hôpitaux », renchérit Rodolphe Temple, responsable sécurité à l’hôpital Foch de Suresnes, en soulignant que la problématique est très différente selon le type d’hôpital : les établissements publics sont généralement des bâtiments énormes et souvent anciens alors que les organismes privés sont plus petits. « Tout dépend aussi de l’environnement géographique : un hôpital en banlieue à forte concentration démographique n’est pas confronté aux même risques qu’un hôpital dans un département rural », ajoute-t-il.
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
Le 28 janvier 1986, la navette spatiale américaine Challenger explose après seulement 73 secondes de vol, provoquant la mort des…
Handicapé par un manque de visibilité sur l’avenir économique et politique du pays, le marché de la sécurité entre…
Le baromètre des risques Allianz 2026 a été publié le 14 janvier par Allianz Commercial. Les risques liés à…
En matière de sécurité incendie, le plan d’intervention et le plan d’évacuation font souvent l’objet de confusion pour les non-spécialistes.…
À la fin de l’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
Dossier de demande d'autorisation environnementale, vie de l'installation : quand et comment un site Seveso doit-il consulter ou informer…
À lire également