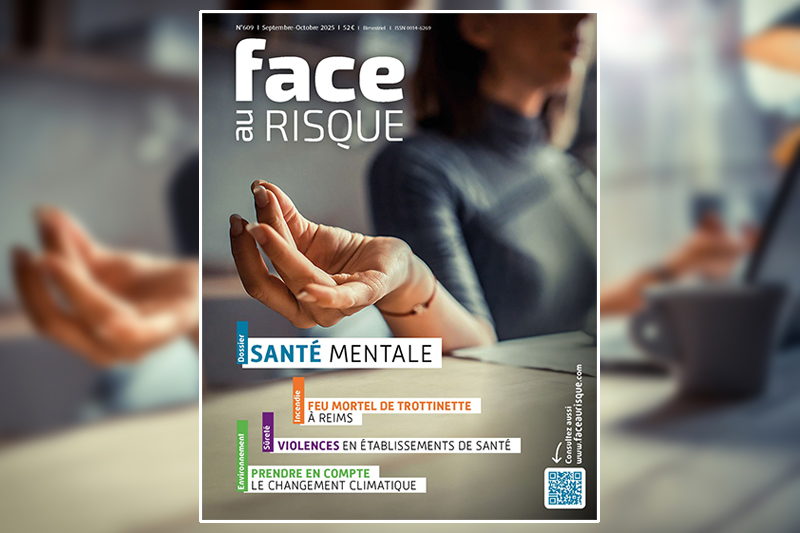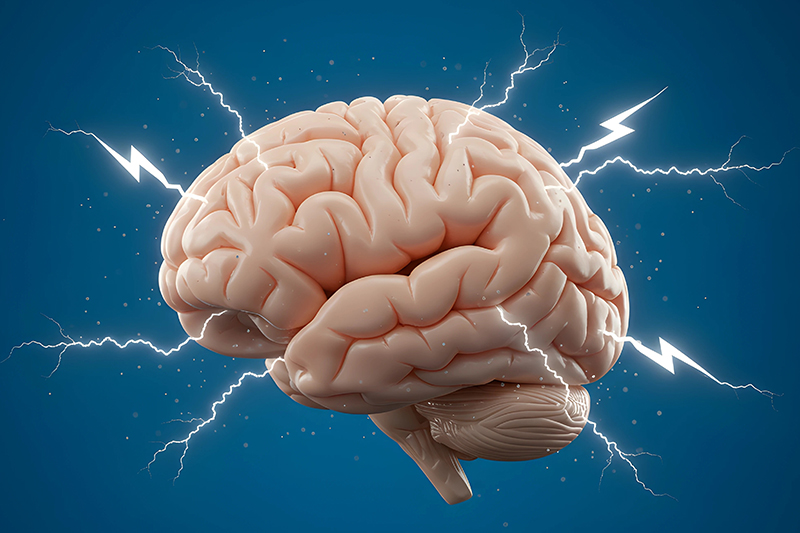10 conseils pour une bonne santé mentale au travail
Comment protéger sa santé mentale et celle des autres ? Éléments de réponse avec Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux (Firps), et Camy Puech, président fondateur de Qualisocial, cabinet spécialisé en santé mentale.

1 Comprendre ce qu’est la santé mentale
Notamment son impact, ce qui l’affaiblit (charge de travail inadaptée, autonomie inadéquate, sentiment de non-reconnaissance, sentiment d’insécurité…) et ce qui la renforce (sentiment d’appartenance, soutien social, marges de manœuvre, sens du travail…) pour pouvoir agir.
Il est aussi nécessaire de comprendre les mécanismes d’adaptation qui permettent à l’organisme de réagir à l’environnement (stress, anxiété, dépression). S’ils sont passagers, ils ne sont pas alarmants, mais ils dégradent la santé mentale s’ils deviennent généralisés.
« Un trouble anxieux, à un moment donné, c’est normal. C’est dans la durée que ça pose problème. Les gens sont conscients qu’ils ont une santé mentale, et qu’elle peut s’avérer mauvaise. En revanche, ils ne savent pas faire la différence entre le stress, l’anxiété et la dépression, constate Camy Puech. On sait comment réagir quand on a mal à la tête, quand on se coupe. Il faut qu’on atteigne le même niveau en santé mentale. »
Faire la différence entre stress, anxiété et dépression
Source : Qualisocial
| Stress | Anxiété | Dépression | |
|---|---|---|---|
| Facteurs déclencheurs | Confrontation à quelque chose de nouveau ou de dangereux. | Crainte d’un événement important à venir ou du futur en général. | Perte de sens de la vie. |
| Mécanisme de réaction | Sécrétion de catécholamine et de glucocorticoïde pour accélérer le rythme cardiaque et alimenter les muscles en sucres. | Alimentation du cerveau pour permettre une suractivité. | Adaptation comportementale afin de s’extraire de la vie par le biais du désir, du plaisir, de l’utilité. |
| Effets indésirables | Fatigue du corps, usure des muscles et articulations, fatigue mentale. Dégradation globale de la santé en cas d’exposition prolongée. | Fatigue, trouble nutritionnel et irritabilité. Perte de la capacité d’action si l’exposition est trop intense ou prolongée. | Baisse de motivation, de l’estime de soi, dégradation des relations sociales et de la santé. Incapacité à sortir du mécanisme si l’exposition est trop intense ou prolongée. |
2 Être à l’écoute et repérer les signaux faibles, pour soi-même et les autres
Les signaux psychologiques : difficulté à se concentrer, à prendre des décisions, oublis inhabituels, nervosité accrue, irritabilité, surréaction, découragement ou lassitude.
Les signaux comportementaux : le fait de s’isoler, de se mettre à l’écart des échanges collectifs, d’être fuyant. Retards répétés, absences, baisse d’implication, agressivité, impatience.
Les signaux physiques : boule au ventre, somnolence, visage fermé, baisse d’appétit, douleurs dorsales, cervicales, troubles du sommeil, maux de tête.
Les signaux relationnels : isolement, conflits plus réguliers, réactions disproportionnées, agressivité, ambiance dégradée…
« Quand on constate un faisceau d’indices, en lien avec la fatigue par exemple, il faut prendre le sujet au sérieux, observe Jean-Christophe Villette. C’est souvent là que tout se joue et qu’une vigilance individuelle et collective peut faire la différence entre un épuisement évité et un drame évitable. »
3 Adopter les bonnes pratiques si on détecte les signaux
Activité physique, sommeil, balance nutritionnelle, activité sociale. En parler à un professionnel de santé mentale peut être une solution.
4 Favoriser les relations de confiance
Puisque certains signaux sont invisibles, il est nécessaire d’échanger régulièrement avec ses collègues.
« Il faut créer dans son équipe un climat de sécurité psychologique. À savoir accompagner le fait que chaque personne, manager compris, se sente autorisée et libre de s’exprimer sans avoir peur d’être jugée ou sanctionnée, souligne Jean-Christophe Villette. On évite le cynisme, le fait de banaliser, de ridiculiser… On valorise la communication comme une source d’information qui aide à travailler ensemble. »
5 Mettre en place une politique complète de prévention
des RPS
À savoir :
- anticiper les risques et les réduire à la source. En mesurant notamment l’impact des projets de transformation sur les individus (arrivée de l’IA par exemple) et en ayant une démarche de qualité de vie au travail ;
- sensibiliser tous les salariés : donner à chacun les moyens de comprendre et d’agir ;
- accompagner et gérer les situations de mal-être : donner accès à des psychologues « qui travaillent en coordination avec le manager, les RH, le médecin du travail », précise Camy Puech.
6 S’intéresser au travail réel
« Un certain nombre de méthodes de diagnostics produisent des résultats qui ne permettent pas de comprendre la réalité des situations de travail, remarque Jean- Christophe Villette. Il faut faire des diagnostics appropriés à l’évolution des organisations, s’intéresser au travail réel et à l’émergence de risques spécifiques, à la fois dans les bénéfices et les dysfonctionnements, au niveau individuel et collectif, pour développer des pratiques qui s’adaptent aux évolutions des organisations. »
7 Communiquer, même les mauvaises nouvelles
« Les chefs d’entreprise ont tendance à ne pas communiquer lorsque les informations sont mauvaises. C’est une très mauvaise pratique, explique Camy Puech. Les troubles anxieux et dépressifs apparaissent notamment lorsqu’on a le sentiment de ne pas contrôler ce qui nous arrive. Ne pas communiquer sur les mauvaises nouvelles empêche le processus psychologique qui permet de faire face à l’incertitude et provoque de l’inquiétude et des troubles anxieux généralisés. » En cas de projet de restructuration par exemple, il est normal de voir apparaître des troubles psychiques. Il faut le savoir pour s’en protéger.
8 Ne pas négliger le facteur humain et l’importance du collectif
« Quand la situation économique se dégrade, l’humain a tendance à se focaliser sur l’urgent, seul, tête baissée, pour limiter les dégâts, illustre Camy Puech. C’est un comportement naturel de réponse au stress, mais c’est souvent insuffisant pour régler la situation, cela favorise le burn-out et les tensions du collectif, ce qui entraîne une dégradation de la santé mentale. Un adage dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». En période de crise, il est important de le garder en tête. »
9 Passer d’une prévention cosmétique à une prévention stratégique
Pour accompagner en profondeur le changement de l’organisation du travail et des pratiques de management. « Deux séances de relaxation ne suffiront jamais à réparer une organisation qui épuise. Parler de santé mentale au travail, c’est parler de gouvernance, de justice organisationnelle, de conditions concrètes pour faire un travail de qualité », partage Jean-Christophe Villette. Si une organisation du travail que l’on ne diagnostique pas reste emprunte d’une charge de travail excessive, d’un manque de sens, d’une autonomie non adaptée, elle va continuer de nourrir les dégradations de la santé mentale.
10 Ne pas oublier la santé mentale des managers
« On transfère souvent la gestion des situations dégradées aux managers. On oublie parfois qu’ils sont parmi les populations les plus stressées et vulnérables. Comment imaginer améliorer la santé mentale au travail quand les managers sont eux-mêmes majoritairement sous pression et en incapacité d’absorber les tensions ? Ils sont devenus les pompiers de la santé mentale, mais on les laisse sans casque ni formation. C’est une forme de maltraitance institutionnelle. Les accompagner n’est pas une option, en commençant par le diagnostic de leur activité réelle », conclut Jean-Christophe Villette.
Article extrait du n° 609 de Face au Risque : « La santé mentale au travail » (septembre-octobre 2025).

Gaëlle Carcaly – Journaliste
Les plus lus…
Ce numéro 609 du magazine Face au Risque (septembre - octobre 2025) consacre un dossier spécial à la santé…
Les générations récentes de véhicules créent de nouveaux risques en cas d’incendie dans les parcs de stationnement. Afin de faire…
Un arrêté daté du 4 septembre 2025 vient clarifier la qualité des cartographies des phénomènes dangereux exigées par l’administration, dans…
L'Alliance pour la santé mentale et le Gouvernement ont lancé, fin août 2025, la charte d'engagement pour la santé…
Fondé en 2014, GAE Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans la prévention des addictions en entreprise. Depuis le…
Acteur majeur de l’environnement, Suez a lancé une réflexion sur la santé mentale en initiant une nouvelle politique de prévention…