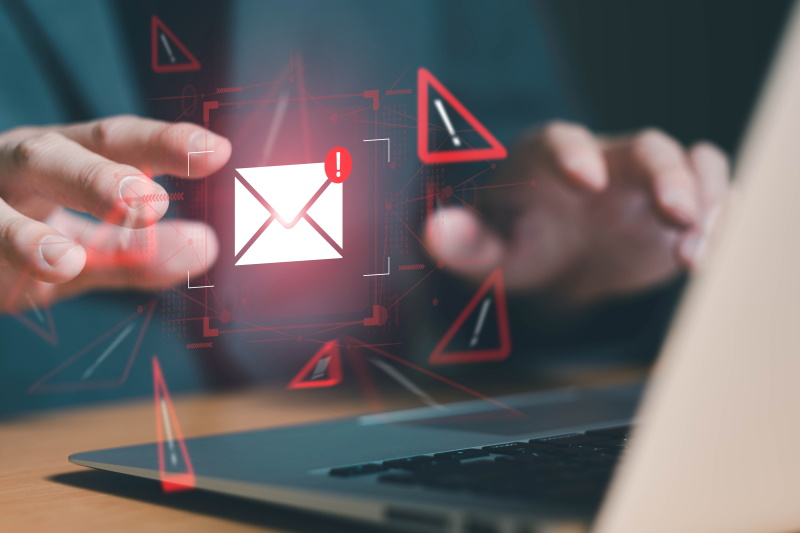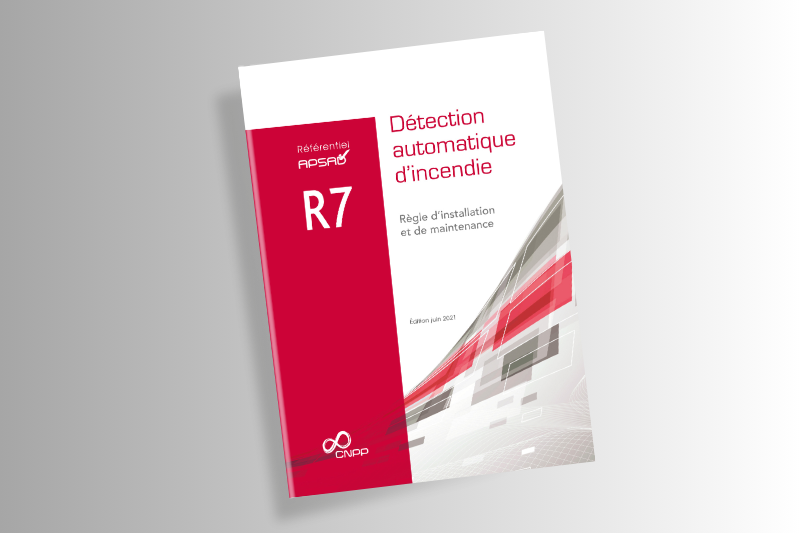Culture du risque. Sensibiliser les populations aux risques industriels et naturels
Nommer un référent unique « risques » par commune ou mettre en place un dispositif d’alerte aux populations, telles sont deux des douze mesures préconisées par la mission chargée de formuler des propositions pour développer la culture du risque.

La mission chargée de concevoir des mesures pour sensibiliser le public aux risques de catastrophes naturelles ou industrielles a rendu son rapport le 6 juillet 2021.
Et c’est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui avait mandaté en décembre 2020 le journaliste Fred Courant (co-animateur de l’émission «C’est pas sorcier») de cette mission. Ainsi, il était aidé dans sa tâche de cinq spécialistes des domaines de l’incendie, des crises, de l’information, de la géographie et de la psychologie.
Ce sont l’incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique du 26 septembre 2019 à Rouen, et les tempêtes Alex en octobre 2020 et Irma en août 2017 qui ont révélé la nécessité de moderniser la culture du risque industriel et du risque naturel.
Populations et risques industriels et naturels
L’objectif principal de la mission : limiter les conséquences humaines, matérielles, financières et psychologiques pour les populations affectées par un accident industriel d’ampleur ou une catastrophe naturelle.
Mais il s’agissait également de reconstruire une confiance mutuelle entre les citoyens et leurs institutions. Et aussi de définir une politique de sensibilisation et d’information attractive adaptée aux différents publics. Le tout, en faisant des propositions qui soient facilement mises en œuvre.
Que faire en cas d'incendie ou d'inondation ? Des réflexes simples existent, mais ne sont pas toujours adoptés.
— Barbara Pompili (@barbarapompili) July 7, 2021
J’ai demandé à Fred Courant, vulgarisateur si connu des fans de C’est pas sorcier, d’imaginer de nouvelles méthodes de sensibilisation.
Nous les traduirons en actes. pic.twitter.com/AwwZIZorjW
Les principales propositions
- Instaurer un événement national annuel, fédérateur et mobilisateur.
- Élaborer un « kit » pédagogique national et téléchargeable.
- Développer et adapter la plateforme « Géorisques » pour en faire le site de référence de la culture du risque.
- Créer des unités mobiles pour aller à la rencontre des habitants.
- Encourager la valorisation des résultats des projets de recherche sur les risques via des supports pédagogiques et grand public
- Sensibiliser les élus, développer leur sens de l’anticipation de crise.
- Inciter les maires à désigner un référent unique « risques ».
- Mieux utiliser la complémentarité des médias historiques/réseaux sociaux afin de s’assurer que les messages sont diffusés par tous les canaux.
- Sensibiliser et former les métiers du bâtiment aux solutions intégrant des mesures préventives.
- Mettre en place un dispositif d’alerte aux populations.
Et Barbara Pompili nous donne rendez-vous à l’automne pour les suite de ce rapport.

Martine Porez – Journaliste
En ce moment
L’association Euralarm a publié un document de position actualisé sur le règlement (UE) 2023/1542, fournissant des orientations aux autorités de…
S’il est aujourd’hui admis que les entreprises doivent garantir un accès facilité aux personnes en situation de handicap moteur, les…
La 2e édition des Assises de la prévention incendie, organisée en novembre 2025 par la FNSPF et la SFPE *,…
Installation, maintenance, utilisation du défibrillateur, responsabilité de l'employeur : que dit la réglementation pour les ERP du 1er groupe…
En cas d'accident du travail, le non-respect par le salarié des consignes verbales reçues n’est pas une condition nécessaire pour…
L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes…