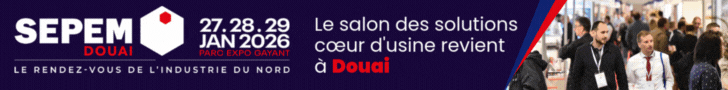Construction bois : « Nous allons créer un statut particulier de bâtiment à structure primaire combustible autorisée »
Jean-Michel Servant, délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, a dévoilé, le 28 février 2025 lors du Forum international bois construction à Paris, l’état d’avancement des travaux interministériels relatifs à la réglementation incendie et la construction bois. Il revient pour nous sur les progrès déjà faits et ceux qu’il reste à faire.

Quel est votre rôle en ce qui concerne la réglementation incendie appliquée à la construction bois ?
Jean-Michel Servant. Je suis délégué interministériel depuis le 15 avril 2024, poste qui n’existait plus depuis une quinzaine d’année, mais avant ça, j’ai fait la plupart de ma carrière dans le conseil et j’ai été président de France Bois Forêt. Le sujet de la réglementation incendie par rapport à la construction bois est l’un des sujets prioritaires sur ma lettre de mission. Les volontés politiques sur ce sujet sont assez claires. Personne n’est contre la sécurité des personnes, ni contre le fait que les secours puissent intervenir en sécurité. Et en même temps, personne n’est contre la décarbonation de notre économie et donc de notre construction.
Tout l’enjeu est de rendre ces objectifs compatibles. J’essaye d’apporter une valeur ajoutée en amenant de la méthode et en essayant de construire des consensus par le travail entre les différentes directions, les différents services et les différents acteurs concernés.
Quelle a été cette méthode ?
Continuez votre lecture… Abonnez-vous !
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.
Les plus lus…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…