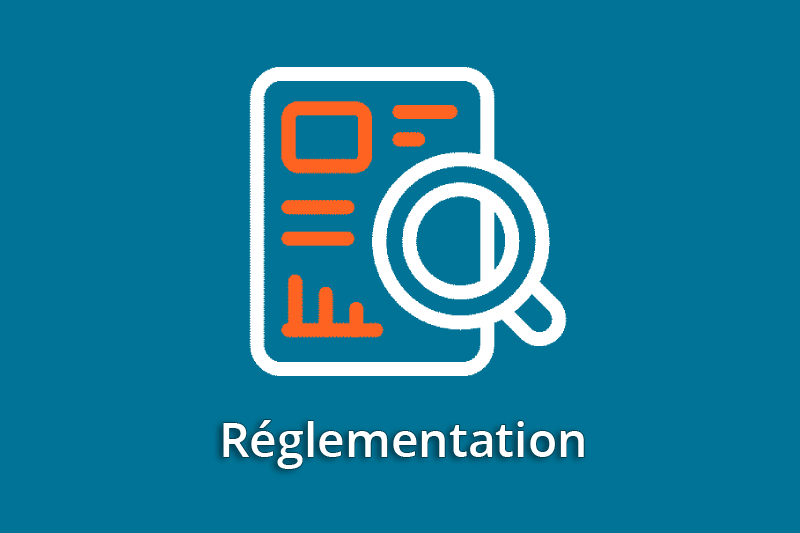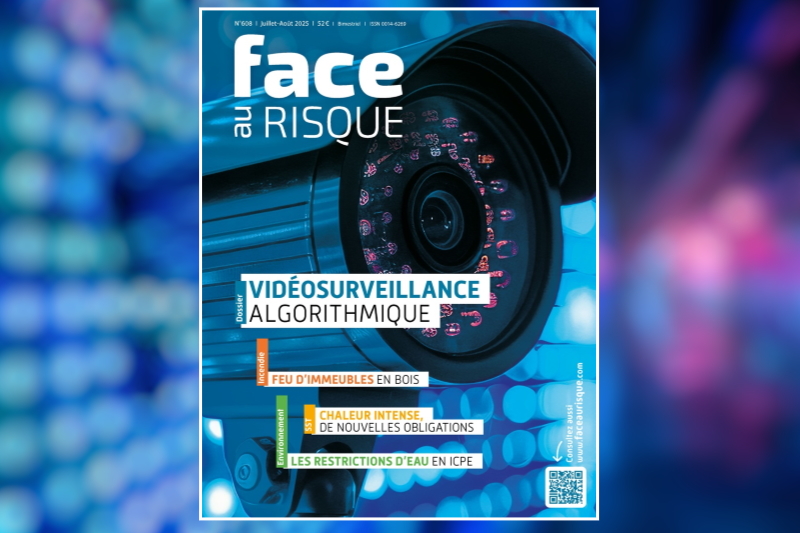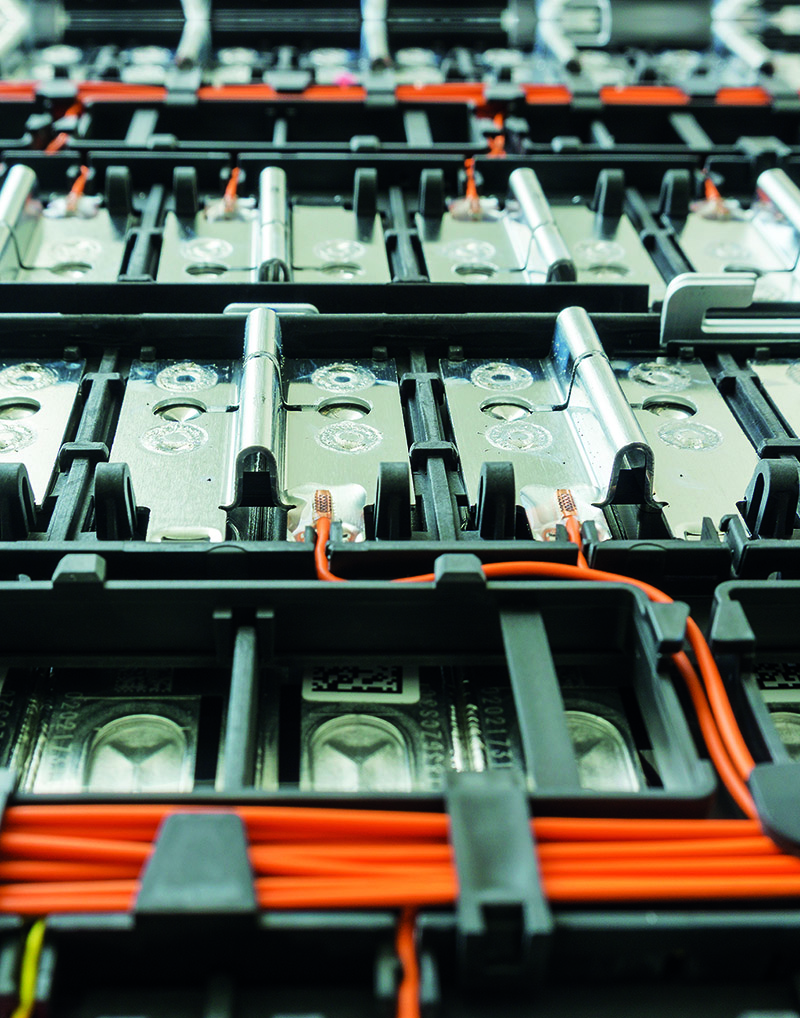Le harcèlement sexuel au travail : ce qu’il est, ce qu’il n’est pas
Alors qu’une personne victime de violences internes sur cinq estime avoir subi un harcèlement sexuel[1], prendre conscience de ce qui relève de ce délit ou non est capital pour les préventeurs.

En droit français, le harcèlement sexuel est défini et prohibé par les articles L. 222-33 du code pénal, L. 133-1 du code général de la fonction publique et L. 1153-1 du code du travail.
Harcèlement sexuel au travail : définition
Les faits de harcèlement sexuel à l’envers d’une personne sont constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Sont assimilés au harcèlement sexuel les faits « consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Est enfin assimilé à du harcèlement sexuel le fait d’imposer, individuellement ou collectivement, à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.
Harcèlement sexuel : les circonstances aggravantes
L’infraction est également constituée lorsque les auteurs sont plusieurs personnes, agissant de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
Ces faits admettent plusieurs circonstances aggravantes, qui alourdissent les peines encourues : abus d’une autorité de droit ou de fait, victime mineure de 15 ans ou particulièrement vulnérable (âge, maladie, handicap ou déficience physique ou psychique, grossesse, dépendance économique), auteurs multiples, utilisation d’un service ou support électronique, présence d’un témoin mineur.
Harcèlement sexuel, ou pas ? Quatre situations en contexte professionnel
1 Le manager de Stéphanie a organisé un rendez-vous pour un motif prétendument professionnel et l’a entraînée dans une chambre d’hôtel en vue d’obtenir des faveurs sexuelles.
Le harcèlement sexuel ne fait ici guère de doute, en raison de la recherche de relations sexuelles, aggravé par la position d’autorité du manager.
2 Caroline se plaint de son collègue Sébastien, qui a procédé à des attouchements sur elle, et lui a à plusieurs reprises fait part de ses préférences sexuelles. Caroline ayant refusé ses avances, Sébastien se montre désormais avec elle verbalement désagréable.
Sébastien se livre ici à des agissements plus graves encore que le harcèlement sexuel : une agression sexuelle. L’article L. 222-22 du code pénal définit ce délit comme « toute atteinte sexuelle (c’est-à-dire tout acte sans pénétration) commise avec violence, contrainte, menace ou surprise », c’est-à-dire tout attouchement imposé sur le sexe ou sur les parties du corps considérées comme intimes et sexuelles : les fesses, les cuisses, la poitrine et la bouche.
3 Clément propose à sa collègue Léa, avec laquelle le courant passe bien depuis plusieurs semaines, d’aller prendre un verre après le travail, puis de dîner ensemble. Léa accepte avec plaisir.
Dans la mesure où Léa et Clément sont tous les deux majeurs, où ils semblent partager une certaine attirance réciproque, et où la proposition de Clément laisse à Léa la faculté totale de consentir ou de refuser, sans nulle forme de contrainte ou de pression, la situation semble être celle de deux adultes qui commencent à partager des sentiments, et ne comporte aucun élément répréhensible.
4 Alexis, 22 ans, est alternant. Sa manager, Marion, lui envoie d’abord des messages anodins : « Bravo pour ta présentation », « Tu apportes une belle énergie ». Puis le ton devient plus personnel : « Tu as un charme fou », « Je te verrais bien à ma place… mais je préfère te garder rien que pour moi 😏 ». Un soir, elle écrit : « Tu sais que tu es très beau ? Si tu n’étais pas mon alternant… Mais bon, tout se négocie 😉 ». Alexis ne répond pas. Le lendemain, Marion ajoute : « Je sens quand tu me regardes que tu as envie qu’on se rapproche. Tu n’as pas à avoir mauvaise conscience, je te trouve très beau. Il n’est pas interdit de joindre l’utile à l’agréable. Et rassure-toi, ça restera entre nous. » Il se sent flatté, mais mal à l’aise. Il dort mal, évite les réunions, redoute ses messages.
Ce cas incarne un harcèlement sexuel numérique : propos répétés, pression implicite, déséquilibre hiérarchique. Même sans contact physique, les dégâts sont réels. Ce type de situation doit alerter : formation des managers, balisage des échanges numériques et dispositif de signalement sont essentiels pour prévenir ces dérives.
[1] Source : baromètre Ekilibre Conseil / OpinionWay sur les « causes racines du mal-être au travail », consultable ici.
À lire également
« Le harcèlement sexuel au travail est plus courant qu’on ne le pense » (en anglais – mai 2025) sur le site de l’Eige (European institute for gender equality).

Philippe Zawieja
Directeur des partenariats stratégiques et de la recherche d’Ekilibre Conseil (Paris), docteur en sciences et génie des activités à risques (Mines ParisTech PSL), chercheur associé aux Universités de Montréal (Québec), Florence (Italie) et Aveiro (Portugal).

Jean-Christophe Villette
Directeur général et fondateur d’Ekilibre Conseil, psychologue du travail et des organisations, ingénieur en maîtrise des risques industriels (Mines ParisTech PSL), consultant-expert, vice-président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux.
Les plus lus…
Le colonel Frédéric Goulet a officié en tant que chef du Bureau de la prévention et de la réglementation…
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, un important incendie a touché le site pétrochimique de l’américain…
Dans un flash Aria daté de juillet 2025, le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (Barpi) rappelle l’importance…
L'entreprise Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré, a répondu aux accusations de l'entreprise Highway France Logistics 8, propriétaire de…
Deux décrets ainsi qu’un arrêté, tous trois en date du 11 juin 2025, portent sur les règles de sécurité incendie…
Ce numéro 608 du magazine Face au Risque (juillet - août 2025) consacre un dossier spécial à la vidéosurveillance…
À lire également